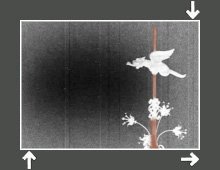Entre les pierres dont le temps a bombé l’agencement qui se voulait régulier, pousse une fine herbe que les pas des invités n’arriveront pas à effacer et qui fait ressortir la forme spécifique de chacune d'elles, mettant en relief l’incroyable unité née de leur juxtaposition. Cette cour traversera encore longtemps le temps; même si la nature tente de prendre le dessus ; tout comme la vie quotidienne qui ensevelit systématiquement les instants; tous ceux qu’elle crée pourtant elle-même. Ce soir, chaque souvenir est un pavé. Et chaque invité, un pavé; de souvenirs.
La cour humide scintille dans la nuit, sous la fraicheur apaisante d’une fine pluie de minuit. Reflétant les visages, les intonations et les postures oubliées de tous ces camarades que je retrouve à présent, sous la lueur diffuse des bougies traçant au sol des directions insolites à des retrouvailles de vingt ans. Dans la chimie des relations humaines, dans l’alchimie des correspondances, la symbolique du lieu et du temps arrêté sur hier, je détruis les souvenirs qui auraient peut-être pu survivre encore comme tel, pour réinjecter leur essence dans le présent. Je me sens flamboyant à l’intérieur, me rendant compte qu’ils n’ont pas vieillis ; je les replace simplement sur le haut d’une pile alourdie par les couches successives de ma vie, tels qu’ils étaient. Tels qu’ils seront à jamais.
Elle est là, au milieu de la cours, figée dans l’éternel, statue dans le jardin de mon imagerie personnelle. Je m’approche d’elle, je tremble autant qu’elle. Même si cela se voit peut-être un peu moins chez moi ; le temps a commencé à la rattraper, moi qui n’en suit encore qu’à m’y préparer par tous les moyens. Inimaginables. Ses yeux bleus se posent sur les miens ; comme quand j’assistais à son cours de français, je me sens surexposé par l’intensité de son regard, qui parle de lui-même. Elle a pris le temps de me lire avant ce soir. Elle me demande ce que je souhaite dire quand j’écris. Je lui parle de redéfinition des évidences, et je lui parle d’Amour. Elle m’assoit sans transition sur un rivage de sa vie ; juste un bouquet de mots choisis pour me parler de cet amour intense qu’elle a connu quand elle avait trente-six ans. Intense, si intense, trop intense. Feu de paille. Je lui parle de celui qui me consume, la relation immédiate et exacte avec cette femme que je connais -je pense- depuis trois cent ans. Et pour déjà encore au moins aussi longtemps. Je lui dis que l’amour pour moi est un feu de forêt. Elle me sourit. Si vraie.
Dans cette cour.
Cette cour qui traversera encore longtemps le temps.
![[- Wiwilbaryu -]](http://4.bp.blogspot.com/_Zo3LJTquitQ/SzuASYGlFCI/AAAAAAAABAI/haZIW4j1h9A/S844-R/newfrontier.jpg)